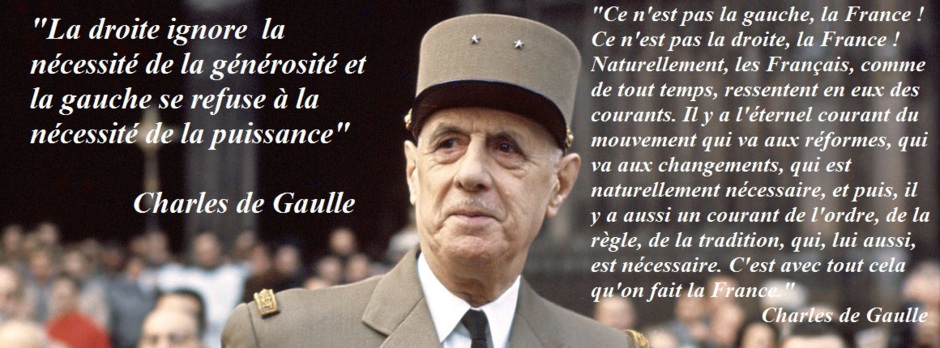
De Gaulle et la construction Européenne...
"Pour organiser l’ Europe, qu’on la prenne donc comme elle est, c’est à dire comme un ensemble formé de peuples très distincts dont chacun a, bien à lui, son corps, son âme, son génie et, par suite, doit avoir ses forces. Renvoyons aux géomètres les plans étranges qui prétendent mêler, à l’intérieur des mêmes unités, les contingents de pays divers pour fabriquer l’armée apatride. Où donc les soldats de cette Babel militaire iraient-ils puiser leur vertu ? Si, pour une coalition, il est nécessaire d’instituer entre Etats, par délégation de tous système unique aux échelons supérieurs du commandement, le principe qui domine tout c’est qu’une armée se bat avant tout pour son pays, sous l’autorité de son gouvernement et sous les ordres de ses chefs. Aucune, je dis aucune, de celle que doit fournir l’Europe ne saurait être ni bâtie, ni employée, autrement."
Charles de Gaulle, discours prononcé à Nîmes, 7 janvier 1951.
"Y a-t-il une France, une Allemagne, une Italie, une Hollande, une Belgique, un Luxembourg, qui soient prêts à faire, sur une question importante pour eux au point de vue national et au
point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que cela leur serait recommandé par d’autres ? Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple
hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois, songeraient à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l’encontre de leur volonté profonde
? Ce n’est pas vrai ! Il n’y a pas moyen, à l’heure qu’il est, de faire en sorte qu’une majorité étrangère puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que, dans cette Europe «intégrée»
comme on dit, il n’y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu’il n’y aurait pas de France, pas d’Europe, qu’il n’y aurait pas de
politique faute qu’on puisse en imposer une à chacun des six états, on s’abstiendrait d’en faire…"
Charles de Gaulle, conférence de presse tenue au palais de l’Elysée, le 15 mai 1962.
"Pas d’ union européenne, disaient-ils, sinon par une intégration à direction supranationale ! Pas d’union européenne, si l’Angleterre n’en fait pas partie ! Pas d’union européenne, sauf
à incorporer dans une communauté atlantique ! » Pourtant, il est clair qu’aucun des peuples n’admettrait de confier son destin à un aréopage principalement composé d’étrangers. De toute façon, c’est
vrai pour la France. Il est clair également, que l’Angleterre, grande nation et grand état, l’accepterait moins que quiconque. Il est clair enfin, que, fondre dans une politique multilatérale
atlantique le position de l’Europe, ce serait en sorte qu’elle-même n’en ait aucune et, dès lors, on ne voit pas pourquoi elle en viendrait à se confédérer."
Charles de Gaulle, conférence de presse tenue au palais de l’Elysée, 31 janvier 1964.
"On peut faire des discours sur l’Europe supranationale. Ce n’est pas difficile: il est facile d’être un jean-foutre."
Charles de Gaulle Réception à l’Elysée, 10 juin 1965
"La France savait aussi bien que quiconque, en tout cas beaucoup mieux que ceux qui ne sont pas européens, qu’il ne peut y avoir d’Europe qu’en vertu de ses nations, que, de par la nature
et l’histoire, notre continent est tel que la fusion n’y est que confusion, à moins qu’elle ne soit l’oppression, qu’on n’est pas un européen si l’on est un apatride, que, par exemple, Chateaubriand,
Goethe, Byron, Tolstoï pour ne parler que des romantiques n’auraient rien valu du tout en volapük ou en espéranto, mais qu’ils sont toujours de grand écrivains de l’Europe parce que chacun d’eux
s’inspira du génie de son pays."
Charles de Gaulle, conférence de presse tenue à l’Hôtel Continental, 12 novembre 1953.
"Dante, Goethe, Chateaubriand, appartiennent à toute l’Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement italien, allemand et français. Ils n’auraient pas beaucoup servi l’Europe
s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé, écrit en quelque « espéranto » ou « volapük » intégré…"
Charles de Gaulle, conférence de presse tenue au Palais de l’Elysée, 15 mai 1962.
"Chaque peuple est différent des autres, avec sa personnalité incomparable, inaltérable, irréductible. Si vous voulez que des nations s’unissent, ne cherchez pas à les intégrer comme on
intègre des marrons dans une purée de marrons. »
« C'est en vertu de cette destination de l’Europe qu’y régnèrent les empereurs romains, que Charlemagne, Charles Quint, Napoléon, tentèrent de la rassembler, qu’Hitler prétendit lui imposer son écrasante domination. Comment, pourtant, ne pas observer qu’aucun de ces fédérateurs n’obtient des pays soumis qu’ils renoncent à être eux-mêmes ? Au contraire, l’arbitraire centralisation provoquera toujours, par chocs en retour, la virulence des nationalités. Je crois donc qu’à présent, non plus qu’à d’autres époques, l’union de l’Europe ne saurait être la fusion des peuples, mais qu’elle peut et doit résulter de leur systématique rapprochement."
Charles de Gaulle, Mémoires d'Espoir, pages 181
"Pour pouvoir aboutir à des solutions valables, il faut tenir compte de la réalité. La politique n’est rien d’autre que l’art des réalités. Or, la réalité, c’est qu’actuellement, l’Europe
se compose de nations. C’est à partir de ces nations qu’il faut organiser l’Europe et, s’il y a lieu, de la défendre. Au lieu d’une fusion intolérable et impraticable, pratiquons l’association. En
poursuivant des chimères, on a déjà perdu des années."
Charles de Gaulle, conférences de presse tenue à l’Hôtel Continental, 25 février 1953.
"Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur les réalités. Bien entendu on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant «
l’Europe ! », « l’Europe ! », « l’Europe ! » mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien. Je répète: il faut prendre les choses comme elles sont. (…)
Alors vous en avez qui crient: « Mais l’Europe, l’Europe supranationale ! Il n’y a qu’à mettre tout cela ensemble, il n’y a qu’à fondre tout cela ensemble, les français avec les allemands, les
italiens avec les anglais, etc. » Oui, vous savez, c’est commode et quelques fois c’est assez séduisant, on va sur des chimères, on va sur des mythes mais ce ne sont que des chimères et des mythes;
Mais il y a les réalités, et les réalités ne se traitent pas comme cela. Les réalités se traitent à partir d’elles-mêmes."
Charles de Gaulle, deuxième entretien radiodiffusé et télévisé avec Michel Droit, 14 décembre 1965.
"(…) Or on sait, Dieu sait si on le sait ! Qu’il y a une conception différente au sujet d’une fédération européenne dans laquelle, suivant les rêves de ceux qui l’ont conçue, les pays
perdrait leur personnalité nationale, et où, faute d’un fédérateur, tel qu’à l’Ouest tentèrent de l’être - chacun d’ailleurs à sa façon - César et ses successeurs, Charlemagne, Othon, Charles Quint,
Napoléon, Hitler, et tel qu’à l’Est s’y essaya Staline, ils seraient régis par quelque aréopage technocratique, apatride et irresponsable. On sait aussi que la France oppose à ce projet contraire à
toute réalité le plan d’une coopération organisée des états évoluant, sans doute, vers une confédération. Seul, il pourrait permettre un jour l’adhésion de pays tels que l’Angleterre ou l’Espagne
qui, comme le nôtre, ne saurait accepter de perdre leur souveraineté. Seul, il rendrait concevable dans l’avenir l’entente de l’Europe tout entière."
Charles de Gaulle, conférence de presse tenue au Palais de l’Elysée, 9 septembre 1965.
"Eh quoi ? Ces deux peuples se battent depuis plus de vingt siècles; l’Allemagne est sans relâche en proie à l’instinct de domination, hier encore il s’en est fallu de bien peu pour
qu’elle ne tuât la France ! Rien n’est plus simple que d’arranger cela. Mélangeons cette France et cette Allemagne ! En particulier puisque la France victorieuse a une armée et que l’Allemagne
vaincue n’en a pas, supprimons l’armée française ! Créons ensuite une armée apatride faite de français et d’allemands…"
Charles de Gaulle, conférence de presse, novembre 1953.
"L’essentiel pour jouer un rôle international c’est d’exister par soi même, en soi même chez soi ».
Charles de Gaulle, 1959.
"Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aréopages internationaux serait incompatible avec les droits et les devoirs de la république."
Charles de Gaulle, 1963.
"Après tant de leçons, on pourrait penser que, la guerre finie, les milieux qui prétendent conduire l’opinion se montreraient moins disposés à la subordination. Il n’en n’est rien. Au
contraire! Pour l’école dirigeante de chaque parti politique, l’effacement de notre pays est devenu une doctrine établie et affichée. Tandis que du côté communiste, il est de règle que Moscou a
toujours raison, toutes les anciennes formations professent le « supranational », autrement dit la soumission de la France à une loi qui ne serait pas la sienne. De là, l’adhésion à « l’Europe » vue
comme une construction dans laquelle des technocrates formant un « exécutif » et des parlementaires s’investissant du législatif -la grande majorité des uns et des autres étant formée d’étrangers -
auraient qualité pour régler le sort du peuple français. De là, aussi, la passion pour l'organisation atlantique qui mettrait la sécurité, par conséquent la politique, de notre pays à la discrétion
d'un autre. De là, encore, l'empressement à subordonner les actes de nos pouvoirs publics à l'agrément d'institutions internationales où, sous les apparences de délibérations collectives, s'exerce en
toutes matières, politiques, militaires, économiques, techniques, monétaires, l'autorité suprême du protecteur et où nos représentants, sans jamais dire: "nous voulons", ne feraient que "plaider le
dossier de la France". De là, enfin, l’incessante irritation provoquée dans le gent partisane par l’action que je vais mener au nom d’une nation indépendante.
Mais, en revenche, les soutiens ne me manqueront pas. Sentimentalement, j'aurai celui de notre peuple qui, sans être aucunement porté à l'outrecuidance, tient à garder sa personnalité, d'autant plus qu'il a failli la perdre et qu'il constate que, partout, les autres affirment ardemment la leur, qu'il s'agisse de souveraineté, de langue, de culture, de production, voir de sport."
Charles de Gaulle, Mémoires d'Espoir, pages 179 - 180.
"Walter Hallstein est le président de la commission. Il épouse ardemment la thèse du super-état et emploie toute son habile activité à obtenir que la communauté en prenne le caractère et
la figure. De Bruxelles, où il réside, il a fait comme sa capitale. Il est revêtu des aspects de la souveraineté, dirigeant ses collègues entre lesquels il répartit les attributions, disposant de
plusieurs milliers de fonctionnaires qui sont nommés, affectés, promus, rétribués, en vertu de ses décisions, recevant les lettres de créance d'ambassadeurs étrangers, prétendant aux grands honneurs
lors de ses visites officielles, soucieux, d'ailleurs, de faire progresser l'assemblage des six dont il croit que la force des choses fera ce qu'il imagine.
Cette divergence capitale entre la façon dont la commission de Bruxelles conçoit son rôle et le fait que mon gouvernement, tout en attendant d'elle des études et des avis, subordonne les mesures importantes à la décision des Etats, entretient un désaccord latent. Mais comme le traité spécifie qu'au cours du démarrage rien ne vaut sans l'unanimité, il suffit de tenir la main à ce qu'il soit appliqué pour qu'on ne puisse passer outre la souveraineté française. J'y veille avec soin.
La bataille est longue et dure. Nos partenaires, qui voudraient beaucoup que nous n'ayons pas changé de République, comptent en effet que, cette fois encore, nous nous laisserons aller à sacrifier notre cause à l"intégration européenne", comme cela avait eu lieu successivement pour la C.E.CA. où tous les avantages étaient, à nos frais, attribués à d'autres..."
Charles de Gaulle, Mémoires d'Espoir, pages 195 - 197
"De toute façon et comme c'était à prévoir, on vérifie que, pour aller à l'union de l'Europe, les états sont les seules éléments valables, que si l'intérêt national est en cause rien ni
personne ne doit pouvoir leur forcer la main et qu'aucune voie ne mène nulle part sinon celle de leur coopération.
Ce qui à cet égard, est vrai dans l'ordre économique est évident dans la politique. Il n'y a là, d'ailleurs, rien qui ne soit naturel. A quelle profondeur d'illusion ou de parti pris faudrait-il plonger, en effet, pour croire que des nations européennes, forgées au long des siècles par des efforts et des douleurs sans nombre, ayant chacune sa géographie, son histoire, sa langue, ses traditions, ses institutions, pourraient cesser d'être elles-mêmes et n'en plus former qu'une seule ? A quelles vues sommaires répond la comparaison, souvent brandie par des naïfs, entre ce que l'Europe devrait faire et ce qu'ont fait les Etats-Unis, alors que ceux-ci furent créés, eux, à partir de rien, sur une terre toute nouvelle, par des flots successifs de colons déracinés ? Pour les six, en particulier, comment imaginer que leurs buts extérieurs leur deviennent soudain communs, alors que leur origine, leur situation, leur ambition sont très différentes ?"
Charles de Gaulle, Mémoires d'Espoir, pages 200-201
"Du moment...que Vichy...acceptait d'asservir l'Etat à un Etat ennemi, il perdait toute qualité pour représenter et diriger la France, car, pour une grande nation, il n'y a pas de
légitimité en dehors de l'indépendance."
Charles de Gaulle, discours prononcé à Bordeaux le 15 mai 1947, in Discours et Messages, t. 2, p.76.
"La dégradation de l'Etat entraîne infailliblement l'éloignement des peuples associés, le trouble de l'armée au combat, la dislocation nationale, la perte de
l'indépendance..."
Charles de Gaulle, déclaration du 15 mai 1958, in Discours et Messages, t. 3, p.3.
"On a préféré un truc, un organisme bizarre, l'intégration, plutôt qu'une entente entre les nations. Depuis, le Marché commun est entre le zist et le zest."
Charles de Gaulle, Palais de l'Elysée, le 30 décembre 1961
Politique de la chaise vide et compromis du Luxembourg
La crise latente entre la France et ses partenaires de la Communauté économique européenne va se transformer, en 1965, en crise ouverte. Le général de Gaulle s'oppose à deux réformes institutionnelles majeures de la CEE. La première concerne les modalités de vote au sein du Conseil des ministres, censé passer du principe de l'unanimité à celui à la majorité qualifiée. La seconde porte sur le renforcement des compétences budgétaires du Parlement européen (dénommé à l’époque Assemblée des communautés) et de la Commission européenne dans le contexte du financement de la Politique agricole commune (PAC) lors de la phase d'achèvement de l'Union douanière.
La France ne peut accepter une telle évolution qu'elle considère comme un abandon inacceptable de souveraineté. Le général de Gaulle reproche par ailleurs au président de la Commission européenne Walter Hallstein d'avoir préparé sa proposition budgétaire sans s'être préalablement concerté avec les gouvernements des États membres. La France craint enfin qu'une coalition d'États membres ne remette en cause, par le jeu de la décision majoritaire, la politique agricole commune qu'elle a, en effet, eu beaucoup de mal à faire accepter à ses partenaires.
L'attitude de la France, qui préside le Conseil jusqu'au 30 juin 1965, exacerbe de ce fait les désaccords latents entre les conceptions de la Commission Hallstein et celles du Conseil des ministres. En refusant toute solution de compromis, Maurice Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères du second gouvernement Pompidou, provoque l'échec des négociations en vue du règlement financier de la politique agricole. Le 1er juillet, le gouvernement français rappelle à Paris son représentant permanent auprès de la C.E.E. et fait connaître l'intention de la France de ne plus siéger au Conseil des ministres jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. C'est le début de la crise de la «chaise vide». C'est en effet la première fois, depuis l'entrée en vigueur en 1958 du traité de Rome, que la CEE voit son fonctionnement paralysé par un État membre.
Pendant six mois, la France demeure absente de Bruxelles et boycotte la Communauté. Mais, consciente des risques d'un isolement prolongé et de ses conséquences sur l'économie nationale, elle finit par accepter de nouvelles négociations. Lors des réunions à Luxembourg les 17-18 janvier et les 28-29 janvier 1966, le premier ministre luxembourgeois et président en exercice du Conseil, Pierre Werner – réputé pour sa nature consensuelle et ses bonnes relations personnelles avec toutes les parties en place – contribue de manière décisive à trouver un accord qui a sorti la Communauté de l’impasse. Il s’agit du «compromis de Luxembourg», ou des «retrouvailles de Luxembourg». Cette formule, qui sera qualifiée plus tard comme «un accord sur un désaccord» stipule que lorsqu'un pays estime que ses intérêts essentiels sont en jeu, les négociations doivent continuer jusqu'au moment où un compromis acceptable pour tous est trouvé.
Même si ce n'est pas le cas, la France exige le respect de l'unanimité (c'est-à-dire du véto de l'État minoritaire) tandis que les cinq autres partenaires s'en tiennent à la lettre aux dispositions
du traité. Constatant le désaccord, les Six décident néanmoins la reprise des travaux de la Communauté. Ce texte modifie fondamentalement l'esprit du traité CEE en permettant un nouveau moyen de
pression des États sur le Conseil, d'autant qu'il ne définit pas l'intérêt national essentiel laissé au seul jugement de l'État intéressé et ne prévoit pas de procédure d'arbitrage en cas de
désaccord.
Charles de Gaulle se félicite du «compromis de Luxembourg», qui permet de contenir les aspects supranationaux de l'intégration européenne communautaire et de commencer à réorienter la construction
européenne dans un sens intergouvernemental.
Cette médiation européenne couronnée de succès dans un moment difficile alimente l’idée d’une éventuelle candidature de Pierre Werner à la présidence de la Commission des CE. Ce n’est qu’une rumeur,
puisque le Premier ministre luxembourgeois n’a jamais réellement envisagé d’abandonner son mandat électif national.
Dans ses démarches de dialogue et de rapprochement, Pierre Werner a adopté une approche qu’il a théorisée comme une méthode pour toute présidence: «J’ai conçu l’exercice de ma présidence comme devant
assurer surtout la création d’une ambiance et d’un climat de négociation tenant compte des sensibilités à fleur de peau de partenaires aspirant à une entente. Celle-ci ne devait pas laisser de
perdant dans une empoignade de subtilités de langage camouflant un désaccord fondamental persistant».
Depuis, le «compromis de Luxembourg» de 1966 est souvent invoqué par les États membres quand ils entendent bloquer des décisions majoritaires. Contrairement à l'interprétation littérale du texte, ils
s'appuient en effet sur le compromis pour faire, en pratique, de l'unanimité la procédure normale de délibération. Les délégations nationales ont ainsi laissé dégénérer le compromis de Luxembourg en
un droit de veto pour des questions quelquefois secondaires. Le Conseil accepte donc de discuter jusqu'à ce que tous les ministres se satisfassent de la solution proposée. Si l'arrangement de
Luxembourg permet aux Six de sortir de l'impasse, il crée une situation qui engendre parfois un certain immobilisme, la peur de voir bloquée une négociation, limite de facto le droit d'initiative de
la Commission européenne. Cette dérive politique, d'autant plus difficile à gérer que le nombre d'États membres s'accroît sera cependant partiellement corrigée par l'application de l'Acte unique
européen qui, depuis le 1er juillet 1987, étend largement le champ des décisions à prendre à la majorité qualifiée.
De Gaulle et l'OTAN
Aboutissement d'un long processus, la décision que prend le Général couronne une politique de défense indépendante. Au-delà du pragmatisme, elle se fonde sur un principe essentiel à ses yeux : celui de la souveraineté nationale. Une politique qui fait figure aujourd'hui de glorieuse parenthèse.
*Directeur de la revue Libres publiée chez F.-X. de Guibert. Dernier numéro paru : « Vous avez dit gaulliste ? »
Allié mais pas vassal
Le 7 mars 1966, le général de Gaulle adresse à son homologue américain, Lyndon Johnson, une courte lettre qui aura l'effet d'une bombe. Il y annonce le retrait de la France de l'OTAN : « La France, écrit-il, considère que les changements accomplis ou en voie de l'être, depuis 1949, (…) ainsi que l'évolution de sa propre situation et de ses propres forces, ne justifient plus (…) les dispositions d'ordre militaire prises après la conclusion de l'alliance. (…) La France se propose de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamé par la présence permanente d'éléments militaires alliés ou par l'utilisation habituelle qui est faite de son ciel, de cesser sa participation aux commandements « intégrés » et de ne plus mettre de forces à la disposition de l'OTAN. (…) La France croit devoir (…) modifier la forme de notre alliance sans en altérer le fond. »
Dans sa brutalité, cette lettre est le fruit d'une évolution engagée de longue date par le Général, en réalité dès son retour au pouvoir. À y regarder de près, elle constitue un formidable condensé
de sa politique étrangère, une politique certes pleine de pragmatisme mais fondée sur la doctrine de l'indépendance. Une politique à laquelle la France a, peu à peu, tourné le dos.
Trouver un moyen de sortir
Le 14 avril 1966, René Pleven s'en prend avec force à la décision du Général lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Il dénonce notamment « la hâte si insolite, les délais si brefs » d'une telle
décision. Il accuse le gouvernement : « Vous nous avez trompés sur vos intentions, vous ne les avez pas dites à la nation. » Pleven feint la surprise et joue la comédie. Comment pourrait-il ignorer,
lui l'ancien ministre de la Défense, si attentif à la question, le caractère au contraire continu et progressif de la politique du Général vis-à-vis de l'organisation atlantique ? Comment peut-il
s'étonner d'une décision, maintes fois évoquée par le Général et qui fit, de surcroît, l'objet de nombreuses dispositions préparatoires dans les années précédentes ? Cette décision constitue tout
sauf une surprise ; elle couronne l'aboutissement d'une politique.
En effet, dès le 17 septembre 1958, trois ans à peine après son retour au pouvoir, le général de Gaulle fait parvenir au général Eisenhower, Président des Etats-Unis, et à Harold Macmillan, Premier
ministre britannique, un mémorandum dans lequel il constate que « l'organisation actuelle de l'alliance occidentale ne répond plus aux conditions nécessaires de la sécurité » ; en outre, il réclame
une direction désormais tripartite de l'Alliance (Etats-Unis, Grande-Bretagne et France) et « y subordonne tout développement de sa participation actuelle à l'OTAN ». Devant le refus poli des
Anglo-Saxons, il adapte aussitôt son attitude. Le 11 mars 1959, il décide de soustraire au commandement de l'OTAN nos forces navales de Méditerranée. En juin, il fait savoir son refus de stocker sur
le territoire national des armes nucléaires étrangères, ce qui contraint les États-Unis à transférer hors de France deux cent avions militaires.
La France s'engage alors, sans la coopération de ses alliés, dans son propre programme nucléaire, et c'est en février 1960 qu'explose la première bombe atomique française dans le désert du Sahara.
En janvier 1963, le Général rejette la proposition américano-britannique de créer une force nucléaire multilatérale dans l'OTAN et menace de quitter l'organisation si celle-ci se fait malgré son
avis. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il met son veto à l'entrée dans le Marché commun de la Grande-Bretagne, jugée trop atlantiste. Enfin, le 21 juin 1963, la France retire ses forces navales
de l'Atlantique et de la Manche du commandement allié.
Ce rappel chronologique le montre assez nettement : ce n'est pas du jour au lendemain que le Général décide de retirer notre pays de l'OTAN. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris. En réalité, ce
retrait est non seulement progressif mais programmé.
Au sujet du mémorandum de 1958, c'est bien plus tard que le Général révèlera ses véritables intentions, à demi mots : « Dès septembre 1958, écrira-t-il, je hisse les couleurs. (…) Ainsi que je m'y
attends, les deux destinataires de mon mémorandum me répondent évasivement. Rien ne nous retient donc d'agir. »
Devant Alain Peyrefitte, il sera beaucoup plus clair : « Ce mémorandum n'était qu'un procédé de pression diplomatique. Je cherchais alors à trouver un moyen de sortir de l'OTAN et de reprendre ma
liberté, que la IVe République avait aliénée. Alors, j'ai demandé la lune. J'étais sûr qu'on ne me l'accorderait pas. (…) Mais en ne répondant pas à mon mémorandum, ils m'ont permis de prendre des
dispositions qui m'amenaient à sortir peu à peu de l'OTAN, ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas d'abord essuyé ce refus. En fait, c'est ce que nous avons fait pas à pas depuis 1958.
»
« Pas à pas », dit-il, et c'est bien ainsi que l'on doit comprendre sa politique. Celle-ci, souhaitée de longue date, sera mise en œuvre étape après étape, avec résolution mais avec habileté. Aussi sera-t-elle continue mais progressive. Il s'agira de ménager les susceptibilités de nos alliés et ne pas brûler nos vaisseaux, il s'agira d'avancer chaque fois un peu plus loin à mesure de notre propre renforcement et d'attendre, pour sauter le pas, que la France soit à nouveau redevenue maîtresse de son destin. De Gaulle cherchait donc dès son retour au pouvoir « un moyen d'en sortir ». Pourquoi ? Comme toujours chez lui, il faut distinguer ce qui tient aux circonstances et ce qui tient aux principes, faire la part du pragmatisme et celle de la doctrine.
S'adapter aux données nouvelles
De Gaulle est un pragmatique, on ne le dit que trop, et c'est en pragmatique qu'il justifiera sa décision. Dans le texte du mémorandum de septembre 1958, précédemment évoqué, le Général mettra en avant des arguments liés aux réalités géostratégiques pour appuyer ses propositions de réforme de l'organisation atlantique. C'est ce qu'il fera toujours, jusqu'à la décision du 7 mars 1966. D'abord dans sa conférence de presse du 5 septembre 1960 : « Depuis dix ans, il y a eu beaucoup de changement. (…) La France considère que ce qui avait été fait il y a dix ans sur la base de l'intégration doit être mis à la page. (…) Le traité doit être révisé. Du reste, vous savez que le Traité de l'Alliance Atlantique-Nord a été fait en spécifiant qu'il pourrait être révisé après dix ans, et les dix ans sont écoulés. » Á ceux qui s'étonneront d'une telle audace, il ne manquera pas de répondre pour préciser sa pensée. Ainsi s'explique-t-il devant les Français le 21 février 1966, comme pour annoncer sa décision et préparer l'opinion : « Rien ne peut faire qu'une loi s'impose sans amendement quand elle n'est plus en accord avec les mœurs. Rien ne peut faire qu'un traité reste valable intégralement quand son objet s'est modifié. Rien ne peut faire qu'une alliance demeure telle quelle quand ont changé les conditions dans lesquelles on l'avait conclue. Il faut alors adapter aux données nouvelles la loi, le traité, l'alliance, sans quoi, les textes, vidés de leur substance, ne seront plus, le cas échéant, que de vains papiers d'archives, à moins que ne se produise une rupture brutale entre ces formes désuètes et les vivantes réalités. (…) Si la déclaration faite en commun (…) sous forme du Traité de l'Alliance atlantique signé à Washington le 4 avril 1949, reste à ses yeux toujours valable, elle [la France] reconnaît, en même temps, que les mesures d'application qui ont été prises par la suite ne répondent plus à ce qu'elle juge satisfaisant, pour ce qui la concerne, dans les conditions nouvelles. »
Justement, ces conditions nouvelles, quelles sont-elles ?
Le Général constate d'abord que si l'OTAN a été organisée en 1949 dans le cadre de la Guerre froide afin de contenir, et éventuellement de contrer, l'Union soviétique, force est de constater, au
milieu des années 1960, que la menace sur le monde, et notamment sur l'Europe, est sérieusement retombée. Il souligne d'autre part que l'équilibre nucléaire entre les deux mastodontes que sont les
États-Unis et l'URSS a fortement infléchi la doctrine américaine, et que la nouvelle stratégie qui en découle, dite de « riposte graduée », ne garantit plus l'Europe d'une intervention américaine en
cas d'agression atomique.
Il note ensuite que l'Amérique s'engage désormais dans des conflits lointains - c'est le cas au Vietnam -, conflits qui par le système de l'alliance risquent d'entraîner la France dans des guerres
qu'elle ne souhaite pas. Enfin, et surtout, il affirme que l'Europe et a fortiori la France ne sont plus dans la situation catastrophique de l'après-guerre ; la France notamment s'est dotée de son
propre armement nucléaire et cela change considérablement la donne : elle peut non seulement se défendre seule mais peut désormais faire entendre sa voix au sujet de la défense de l'Europe. Georges
Pompidou, alors Premier ministre, reprendra le même argumentaire lorsque le 13 avril 1966 il justifiera la décision gaullienne devant l'Assemblée nationale.
Recouvrer sa pleine souveraineté
Il ne s'agissait évidemment pas pour de Gaulle de s'opposer par principe aux Américains. Les États-Unis étaient nos alliés et le restaient, il le rappellera maintes fois. On sait comme il assurera de son soutien sans faille le président Kennedy lors de la crise de Cuba. Mais tout en réaffirmant le principe de l'Alliance atlantique signée en 1949, le Général s'opposera avec force à l'intégration qui présidait à l'organisation militaire de l'Alliance. Le Traité de 1949 est une chose, l'organisation militaire qui en découle en est une autre. Il n'aura de cesse de faire la distinction entre les deux. Ainsi déclare-t-il le 5 septembre 1960 : « « Il nous paraît que la défense d'un pays, tout en étant combinée, bien entendu, avec celle d'autres pays, doit avoir un caractère national. (…) La France ne peut évidemment pas laisser son propre destin et même sa propre vie à la discrétion des autres. Voilà ce que la France entend par la réforme de cette organisation atlantique, tout en répétant qu'il ne s'agit absolument pas de se séparer les uns des autres, car jamais l'Alliance atlantique n'a correspondu à un besoin aussi profond. » C'est dire si, dans l'esprit du Général, la France n'est utile à ses Alliés que dans la mesure où elle a les mains libres. Sa décision de quitter l'OTAN prise, il précisera ainsi le 21 février 1966 « qu'il s'agit là, non point du tout d'une rupture, mais d'une nécessaire adaptation. »
Dans l'aide-mémoire qu'il remettra le 10 mars 1966 aux quatorze représentants des membres de l'OTAN, il écrira : « L'Alliance doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle apparaîtra nécessaire. Ceci étant affirmé sans équivoque. » En réalité, s'il défend l'alliance, il refuse la subordination, s'il reconnaît la vertu de l'association, il conteste celle de l'intégration. Et c'est bien là ce que Georges Pompidou affirmera le 13 avril 1966 : « Nous n'avons cessé, depuis des années, de proclamer aussi bien notre fidélité à l'Alliance atlantique, c'est-à-dire au traité d'avril 1949, que notre volonté de remettre en cause l'organisation militaire intégrée qui lui avait été superposée. »
L'intégration, voilà bien ce que refuse de Gaulle. Là-dessus, il est inflexible et d'une remarquable constance. Dans sa conférence de presse du 9 septembre 1965, il est par exemple sans ambiguïté : « Nous pouvons et, par conséquent, nous devons avoir une politique qui soit la nôtre. Laquelle ? Il s'agit, avant tout, de nous tenir en dehors de toute inféodation. Certes, dans des domaines multiples, nous avons les meilleures raisons de nous associer avec d'autres. Mais à condition de garder la disposition de nous-mêmes. C'est ainsi, qu'aussi longtemps que la solidarité des peuples occidentaux nous paraîtra nécessaire à la défense éventuelle de l'Europe, notre pays restera l'allié de ses alliés, mais qu'à l'expiration des engagements pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera, pour ce qui nous concerne, la subordination qualifiée d'"intégration" qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin à l'autorité étrangère. » « Inféodation », « subordination », « autorité étrangère » les mots ont dû sembler très durs aux oreilles de nos alliés ; ce sont pourtant ceux qu'employait le Général quand il évoquait l'intégration.
Selon lui, accepter l'intégration revenait à accepter que les armements français soient placés sous commandement étranger, en l'occurrence américain. Cela, il ne pouvait l'accepter. Ainsi déclare-t-il, lors du conseil des ministres du 23 mars 1966 : « L'essentiel de la défense française, aujourd'hui, c'est l'arme atomique. Or, elle n'est pas intégrée. Et la défense américaine, est-ce qu'elle est intégrée ? Les forces américaines sont sous des commandements américains. Les forces alliées sont aussi sous des commandements américains. Il y a deux poids et deux mesures de l'intégration. »
Il faut noter que de Gaulle refuse absolument le principe de l'intégration et ce, quel que soit par ailleurs le sujet, qu'il s'agisse de l'OTAN ou de l'Europe. Pourquoi le Général aurait-il accepté une organisation intégrée de l'Alliance atlantique alors qu'il contestait une telle organisation pour le Marché commun ? Il s'oppose d'ailleurs sur ce point aux conceptions allemandes. « L'idée allemande est que l'intégration est bonne pour tout le monde. En réalité, elle est bonne pour eux. (…) Le mythe de l'intégration leur était commode parce qu'il permettait au vainqueur et au vaincu d'être dans le même sac. C'était le système Monnet. Il est agréable pour les Allemands et inacceptable pour nous. »
J'ai dit que le Général ne s'opposait pas par principe aux Américains. Mais c'est pourtant un principe qu'il opposera aux volontés atlantiques d'intégration. Et c'est là le point central. Au-delà des
considérations stratégiques du moment, au-delà des arguments pragmatiques qu'on a souligné, au-delà même des précautions tactiques dont on a dit que le Général pouvait user, un principe domine
véritablement et ordonne toute la politique de De Gaulle : celui de la souveraineté nationale.
C'est ce qu'il dira aux Français le 21 février 1966 : « Au total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté, dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer et de
forces, et tout élément étranger qui se trouverait en France, ne relèveront plus que des seules autorités françaises. » C'est ce qu'il dira aussi à ses ministres lors du conseil du 16 mars de la même
année : « « Il faudra récupérer beaucoup de choses ; la plus importante d'entre elles, c'est quand même notre souveraineté. » C'est ce qu'il leur répétera lors du conseil du 13 avril suivant : «
Notre intérêt commun, c'est l'Alliance. Nous y sommes avec l'Allemagne et nous y restons avec eux. Non pas sur les mêmes bases qu'auparavant, mais comme l'Etat souverain que nous sommes redevenus.
»
Souveraineté. Voilà un principe que René Pleven et ses amis, qui signèrent une pétition contre la décision du Général, avaient bien du mal à admettre. Dans sa harangue au gouvernement, le 14 avril 1966, Pleven lui reprochera en effet de céder à la « mystique de l'indépendance nationale absolue » (pourquoi « absolue » ? existe-t-il seulement une indépendance « relative » ?) et condamnera « le retour à l'égoïsme sacré », rengaine qui depuis a fait fortune.
Souveraineté, souveraineté… Le président américain Lyndon Johnson a, lui aussi, une étrange conception du principe, si l'on en croit la réponse qu'il fait à de Gaulle le 22 mars 1966 : « Votre point de vue selon lequel la présence de forces militaires alliées sur le sol français porte atteinte à la souveraineté française me laisse perplexe… J'ai toujours considéré leur présence comme une manière sage et prévoyante d'exercer la souveraineté française. » Etrange en effet de considérer qu'un pays exerce sa souveraineté quand il décide de ne justement plus…l'exercer, pour la confier à d'autres. Conception qui, elle aussi, a fait depuis bien des émules, réunis sous l'agréable bannière de la « souveraineté partagée ».
La parenthèse de Gaulle
La décision prise, les 28 000 militaires américains stationnés en France devront par conséquent quitter le territoire. Perspective que le Général envisageait résolument et depuis longtemps.
Sur ce point, le témoignage d'Alain Peyrefitte est éclairant. Le 18 novembre 1964, de Gaulle déclare à son ministre de l'Information : « Si je claque la porte à tout le saint-frusquin de l'OTAN, qu'est-ce qu'il [le président Johnson] peut faire contre moi ? Rien. (…) Notre position est incomparable. Il n'y a personne d'autre qui soit capable d'avoir une politique indépendante, excepté la Chine. (…) Si je veux, je supprime l'OTAN et le commandement américain en Europe, je renvoie Lemnitzer [le commandant en chef de l'OTAN], et tous les Américains qui sont ici. » Le 9 décembre de la même année, il lui annonce : « Tous les types qui sont au SHAPE vont être obligés de quitter la France. » Et, le 16 décembre suivant : « Entre nous et les Américains, sous des dehors courtois, c'est la lutte. Nous sommes les seuls qui leur tiennent tête ; alors, ils ont décidé de nous combattre durement. Tels qu'ils sont, les Américains, c'est-à-dire une démocratie, ça n'ira pas très loin. Seulement, ça ira tout au moins jusqu'à ce qu'ils quittent la France. Leurs troupes et leurs chefs. »
Ses ministres pouvaient voir d'abord dans ce déménagement des difficultés pratiques à régler ; de Gaulle, lui, n'y voyait qu'une question de principe. Là aussi, l'intendance suivrait. Au conseil du 9 mars 1966, il constate : « Nous sommes un pays dans lequel, depuis vingt-cinq ans, il n'est pas né un Français qui se souvienne d'une France sans troupes étrangères. Ça ne peut pas durer éternellement » Au conseil restreint du 2 juin suivant, il est encore plus catégorique : « Ce qu'il faut, c'est enlever les soldats américains ; sinon, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas éternellement chez nous, comme en pays occupé. » De Gaulle comparant en conseil la présence des soldats US à celle d'une force d'occupation, n'est-ce pas une preuve supplémentaire de son puisant attachement à l'indépendance nationale ?
Inutile de dire que, face à cette fermeté gaullienne, les autorités d'outre-Atlantique ne resteront pas de marbre. Au contraire, elles sauront organiser la riposte, provoquant une vague de francophobie (déjà !) dans l'opinion américaine, l'ambassadeur Bohlen souhaitant même réveiller l'opinion française contre de Gaulle et pariant sur un changement de pouvoir lors des législatives de 1967. Michel Debré dans ses Mémoires note à ce sujet : « A la suite de la décision prise par le général de Gaulle de mettre fin à l'absurde "intégration" qui plaçait nos armées et, de ce fait, notre politique de défense sous le commandement américain et malgré le maintien de l'essentiel, c'est-à-dire le Pacte atlantique, nos rapports avec les dirigeants de Washington manquent de chaleur. C'est le moins que je puisse dire ! (…) Quel que soit l'éclat universel dont bénéficie le Général, ces dirigeants ne peuvent concevoir que l'Occident ne les suive pas aveuglément. Il est clair que l'administration et, avec elle, l'ensemble de ceux qui comptent aux Etats-Unis traitent d'une manière soupçonneuse la France du général de Gaulle et regrettent le temps des gouvernements obéissants de la IVe République »
C'est bien ces gouvernements-là, peut-être celui de René Pleven, que regretteront en effet les États-Unis. En témoigne la circulaire qu'enverra le secrétaire d'État Dean Rusk à tous les ambassadeurs
américains des pays de l'OTAN : « Nous devons accorder peu d'importance aux opinions gaullistes. Nous devons agir avec l'idée que le leadership de De Gaulle en France est temporaire, qu'il sera
remplacé par un gouvernement plus attentif aux souhaits de l'opinion publique, et donc plus favorable à l'OTAN » - chose en effet qui ne manquera pas de se produire quelque trente ans plus
tard.
Quant aux autres alliés, membres de l'OTAN et souvent européens, après avoir désavoué la position française de mars 1966, ils resteront fidèles au principe de l'intégration. D'ailleurs, la défense européenne n'a jamais été envisagée par eux que comme une composante d'une défense atlantique. C'est ainsi que le Traité de Maastricht qu'adopta la France en 1992, tout comme le Traité constitutionnel européen qu'elle a rejeté en 2005, consacrèrent le principe d'une politique européenne de sécurité commune « compatible » avec les options principales de l'OTAN. Récemment encore, au Parlement européen, les pays nouvellement admis dans l'Union européenne exhibaient à grand renfort d'affiches leur euro-atlantisme.
Finalement, en décembre 1995, la France réintégrait, après un rapprochement progressif, le comité militaire et le conseil des ministres de l'OTAN, avec le fol espoir d'influer sur la réforme de l'organisation. Las, alors que la fin de l'Union soviétique aurait en effet justifié une réforme profonde de l'OTAN et peut-être sa complète remise à plat, perspective que seul réclama l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, le système au contraire s'orienta vers une domination plus grande des Etats-Unis et de l'intégration. Paul-Marie de La Gorce, qui n'était pas en la matière le moins informé et qui n'était pas non plus homme à formules outrancières, pouvait titrer alors sur le « retour honteux de la France dans l'OTAN ».
Ainsi, la politique résolue du général de Gaulle vis-à-vis de l'OTAN, politique, progressivement affirmée jusqu'au point d'orgue du 7 mars 1966, politique pragmatique mais fondée sur le principe de la souveraineté nationale, politique qui seule eût permis une défense européenne indépendante, n'avait été qu'une parenthèse. L'Histoire n'en finira donc jamais de nous surprendre. Contestant de Gaulle, René Pleven affirmait en 1966 que « la grandeur d'un pays n'est pas d'avoir les mains libres. » Force est de constater, quarante ans après, que c'est au héraut de la IVe République que l'on a donné raison.
Raphael Dargent







